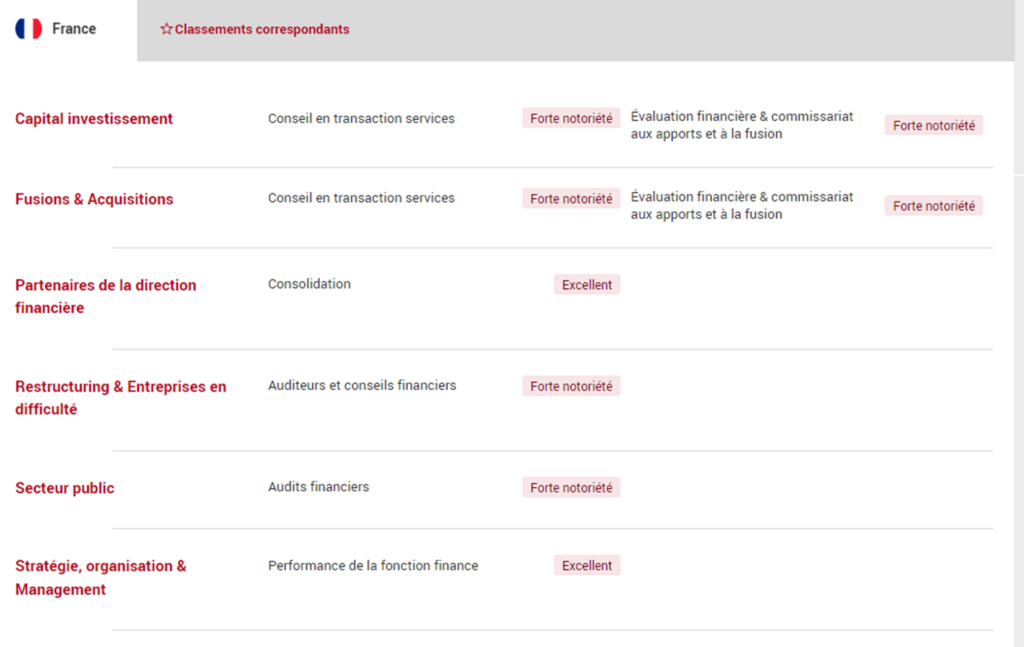Les investisseurs et autres parties prenantes s’intéressent de plus en plus aux effets potentiels du changement climatique sur les modèles commerciaux, les flux de trésorerie, la position financière et la performance financière des entreprises.
Le projet “Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements” a été lancé par l’International Accounting Standards Board (IASB) le 23 mars 2023, afin d’améliorer la communication des risques liés au climat dans les états financiers des entités.
L’objectif n’est pas de développer un nouveau standard « Climat » ou de nouvelles règles de comptabilisation mais de clarifier la manière dont les entités rapportent les incertitudes liées aux enjeux climatiques, dans leurs états financiers, et d’assurer la cohérence avec les informations produites en dehors des comptes, et notamment le reporting de durabilité.
L’IASB a donc décidé de fournir des exemples illustratifs pour montrer comment une entité peut appliquer les normes comptables IFRS et améliorer la présentation des informations sur ces incertitudes liées aux enjeux climatiques et autres incertitudes dans les états financiers. Ces exemples accompagneront les normes comptables IFRS existantes.
Les exemples illustratifs seront au nombre de 8 et adresseront les thématiques suivantes :
- La matérialité (exemple 1& 2) : identifier une information comme matérielle en se basant sur des facteurs qualitatifs, alors même que l’impact sur les comptes est non significatif ;
- Les informations spécifiques et générales sur les hypothèses clés et sources d’incertitudes à communiquer (exemple 3 à 7) ;
- La désagrégation (exemple 8) : présentation distincte des actifs en fonction de leur exposition aux risques de transition, en lien avec IFRS18.
L’IASB publiera un exposé-sondage afin d’obtenir des retours des parties prenantes sur les exemples proposés. Cet exposé sondage est attendu sur le troisième trimestre 2024. Une période de commentaires de 120 jours sera ouverte.
Quelles seront les implications pour les entreprises ?
Les implications du projet “Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements” pour les entreprises sont significatives.
Les entreprises devront évaluer les risques liés au climat de manière plus approfondie. Cela peut inclure des analyses de scénarios, des évaluations des vulnérabilités et des mesures d’atténuation. Notamment, les entreprises, dans le cadre des tests d’impairment (IAS 36), seront amenées à détailler les hypothèses en lien avec les incertitudes climatiques et à communiquer sur la sensibilité de la valeur comptable des actifs aux changements d’hypothèses.
Les entreprises devront fournir des informations plus détaillées sur les risques liés au climat et d’autres incertitudes dans leurs états financiers. En effet, IAS 1 requiert de communiquer sur les incertitudes matérielles pouvant avoir un impact significatif sur la compréhension des comptes. Renforcer les informations sur l’incidence des enjeux climatiques permettra aux investisseurs et aux parties prenantes de mieux évaluer ces risques.
Ce projet “Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements” est d’autant plus important au regard d’IFRS 18, Présentation et informations à fournir dans les états financiers. Cette nouvelle norme a vocation à remplacer la norme IAS 1 et sera d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2027.
L’objectif d’IFRS 18 est d’améliorer l’utilité des informations présentées dans les états financiers primaires et les notes annexes afin de les rendre plus transparentes et comparables. Cela permettra aux investisseurs et aux autres utilisateurs des états financiers de mieux comprendre la performance financière des entreprises et de prendre des décisions plus éclairées.
Elle introduit une nouvelle catégorisation des produits et des charges visant à améliorer la structure du compte de résultat. De nouveaux sous-totaux sont requis afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre la performance financière de l’entreprise. IFRS 18 impose également que les entreprises fournissent plus d’informations sur les indicateurs alternatifs de performance qu’elles utilisent pour gérer leur activité. Cela inclut une description de ces indicateurs, comment ils sont calculés et leur importance pour la performance financière de l’entreprise.
Lors de la mise en œuvre d’IFRS 18, les entreprises devront inclure, dans la nouvelle présentation, l’incidence des enjeux climatiques sur les états financiers.
Par ailleurs, le projet “Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements” visant à renforcer la connectivité entre les informations financières et extra-financières, les entreprises devront considérer les impacts du changement climatique et d’autres incertitudes dans leur processus de reporting. Afin d’assurer cette connectivité, il sera nécessaire à l’entreprise de faire communiquer plusieurs types de reporting utilisant des sources de données différentes. La collaboration des départements financiers et durabilité est indispensable pour assurer la cohérence et la complémentarité des informations communiquées aussi bien au sein du rapport financier que du rapport de durabilité, la CSRD.
La transparence accrue et la prise en compte des risques climatiques peuvent avoir un impact sur la valorisation des entreprises. Les investisseurs pourraient réévaluer leurs décisions d’investissement en fonction de ces informations.
En résumé, le projet IASB contribuera à renforcer la transparence et la connectivité entre les informations financières et extra-financières, y compris celles liées au climat. Il se retrouve aux confins des futurs enjeux de communication de l’entreprise, comprenant la nouvelle présentation des états financiers et les nouvelles obligations de reporting extra financier, la CSRD.